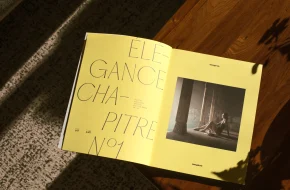Témoignages d’un temps révolu ou parfois toujours d’actualité, les métiers d’autrefois constituent de précieux marqueurs pour découvrir le mode de vie des territoires alpins au fil des siècles. A Megève, ils font partie intégrante de la culture et sont étroitement liés à l’art de vivre mégevan, ainsi qu’au savoir-faire artisanal local.

Megève et la tradition équestre
Au fil des siècles, des liens affectifs ont été tissés entre les Mègevans et leurs chevaux. Foires, élevage, perpétuation de la race de la jument de Megève, traîneaux et calèches… A Megève, la tradition équestre est enracinée dans l’histoire du village depuis des siècles. Le cheval représente un atout dans l’animation touristique locale avec les incontournables traîneaux de la place de l’église et les grandes manifestations annuelles comme le Jumping International ou le Concours aux Poulains. L’élevage équin a commencé à se développer au milieu du XVIIIe siècle durant la Guerre de Succession d’Autriche, tandis que la Savoie était alors envahie par l’armée espagnole. Au XIXe siècle, avec trois grandes foires aux bestiaux annuelles, Megève est devenue le plus grand centre d’élevage de la race chevaline de Haute-Savoie.
Megève, ses traîneaux et ses cochers
Après la Première Guerre mondiale, l’essor du tourisme ouvre un nouveau chapitre de l’histoire, les traineaux qui servent au déneigement sont exploités pour le tourisme. Dans l’entre-deux-guerres, des paysans mègevans commencent à promener les touristes sur leur char à banc qu’ils utilisent pour aller à la messe ou pour se rendre au marché de Sallanches, puis sur un traineau tiré par le cheval de la ferme. Dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, M. Charles Feige, le Maire de Megève attribue 40 places de traîneaux aux agriculteurs pour aider à utiliser les chevaux en dehors des périodes des travaux des champs. Cette double activité représente pour eux un complément de revenu bénéfique pour l’activité agricole. A la fin du XXième siècle, on ne compte plus que 22 cochers sur les 40 places accessibles aux natifs de Megève et de Demi-Quartier à travers l’achat d’une “licence” ou d’un numéro d’exploitant.

Vous aimez que l’on vous conte les histoires d’antan ? Il n’y a pas qu’à travers les récits qu’il est possible de faire renaître la vie domestique de nos ancêtres et la mémoire d’un pays. Les objets portent aussi en eux toute l’émotion et le souvenir des gestes oubliés et des traditions séculaires perpétuées de génération en génération. A Megève, les vieux métiers ont évolué avec les us et coutumes de la vie montagnarde autour des trois grandes thématiques suivantes : l'agriculture, le textile, l'artisanat.
L’histoire du fuseau, une saga mègevanne
Haut-lieu de la mode, Megève a toujours cultivé un certain sens de la distinction et de l’élégance, en se taillant une place de toute importance dans l’industrie du textile. C’est ainsi que le nom d’Armand Allard est gravé dans les livres d’histoire des créateurs de mode. En 1930, Armand Allard habille avec audace son neveu Emile Allais, le plus célèbre des skieurs de Megève de l’époque dans son atelier de la place de l’Eglise en créant le fameux « pantalon-sauteur ».
Ce fuseau aux lignes aérodynamiques qui offre une excellente prise au vent et une silhouette parfaitement gainée à la gente féminine va rapidement supplanter le pantalon norvégien large et bouffant. Après-guerre, le fuseau devient une icône incontournable des sports d’hiver et un accessoire de mode incontournable, à la montagne comme à la ville. Aujourd’hui, la saga familiale poursuit sa lancée dans la boutique haut de gamme située au cœur du village dans la légendaire maison du créateur de fuseau, tout en signant des collections qui brillent au-delà des frontières et en conservant l’esprit de la griffe.


La luge de Megève
« La luge de Megève » est une marque déposée par un designer suisse du nom de Zürcher, alors collaborateur de l’architecte Henry Jacques Le Même, installé depuis 1925 à Megève. Conçue en bois de frêne et dotée de lugeons semblables à des skis, elle est déclinée en trois tailles. L’atelier de son fabricant, un certain M. Joseph, se trouve à « Pirracroste », un bâtiment situé au lieu-dit Le Coin appartenant à René Morand. Au milieu des années 30, la famille Grange-Evrard, qui tenait auparavant une quincaillerie à Megève, reprend la fabrication, avec le concours d’un artisan menuisier de Combloux et se lance dans la conception de skis en bois et de traineaux de secours, respectivement commercialisés sous les marques « Le Brévent » et « Sylvand ».
La Croix de Megève
Fabriquée originellement vers 1750 par un orfèvre de Turin, la célèbre croix-grille est alors achetée par les conscrits mègevans et rapportée à leur promise à l’issu de leur service militaire qu’ils effectuent alors dans le Piémont italien. Transmise de génération en génération à la fille la plus méritante de la famille ou à la filleule, la Croix de Megève cesse progressivement d’être portée après le rattachement de la Savoie à la France en 1860. Néanmoins, sa fabrication continue de perdurer grâce au savoir-faire de l’artisan joaillier Dominique Joly-Pottuz qui la décline en plusieurs modèles. De nos jours, la Croix de Megève brille encore lors des fêtes patrimoniales organisées au cœur du village alpin.

Thématiques